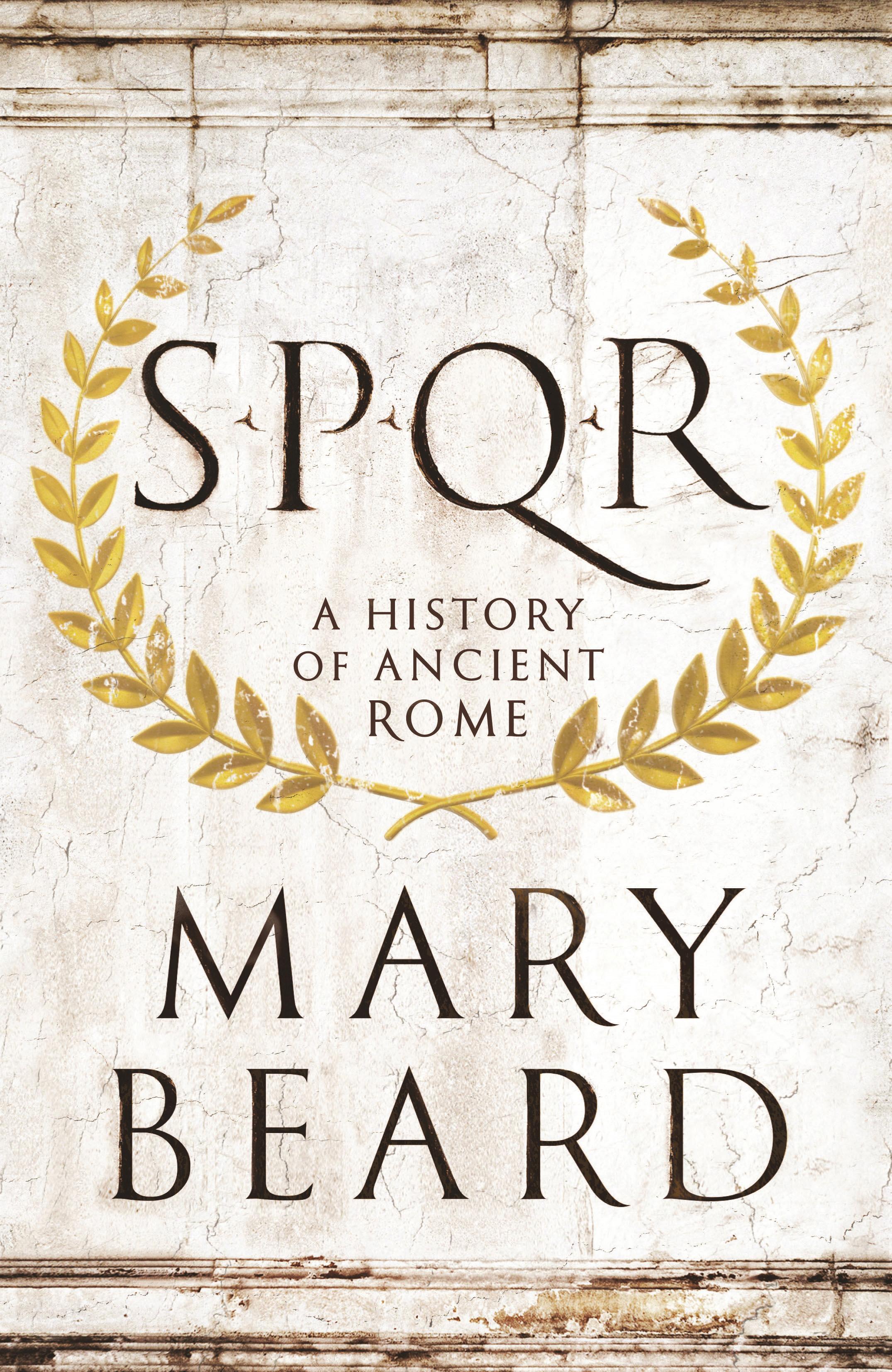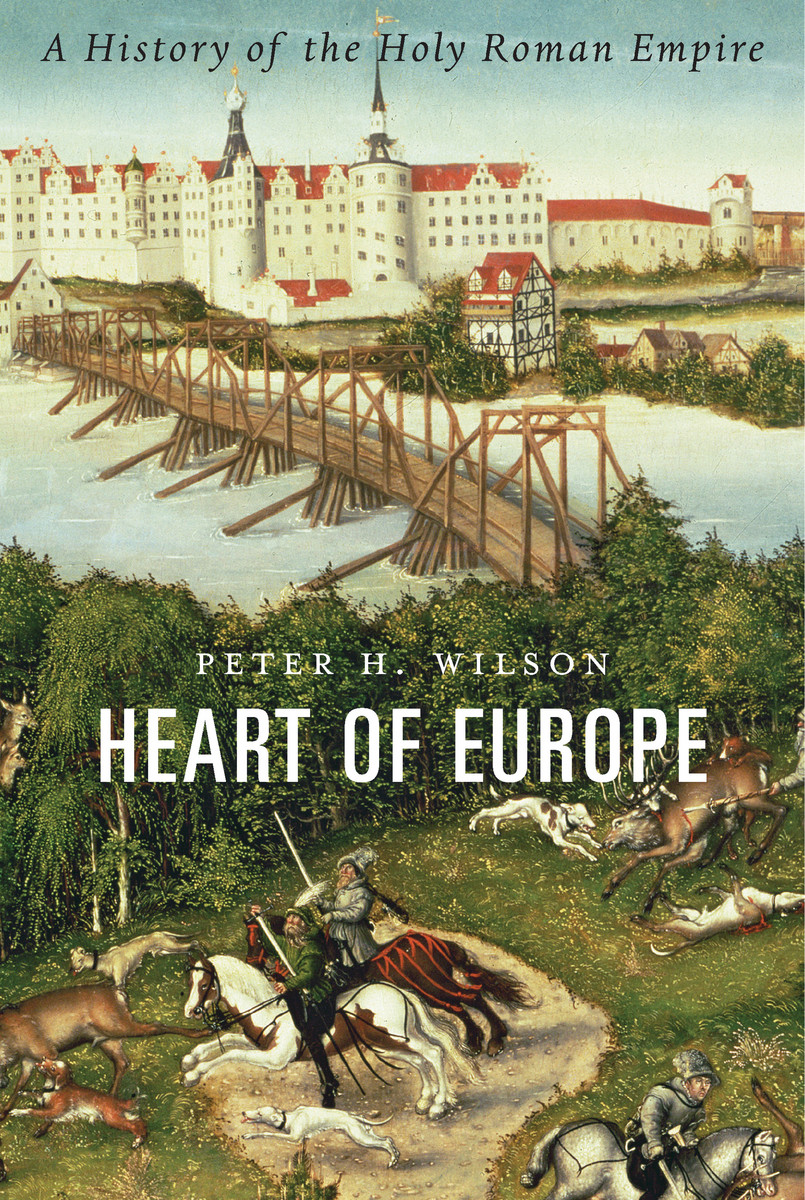L’Empire romain sous un autre jour
Partant de Romulus pour terminer avec l’Union européenne actuelle, en passant par les empires d’Auguste et de Charlemagne, trois éminents historiens s’intéressent à l’Europe et à son incessante quête d’unité.
S.P.Q.R.: A History of Ancient Rome
Mary Beard. 2015. Liveright Publishing, W.W. Norton & Company, New York, 608 pages.
Augustus: First Emperor of Rome
Adrian Goldsworthy. 2014. Yale University Press, Newhaven and London. 624 pages.
Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire
Peter H. Wilson. 2016. Belknap Press, Harvard University Press, Cambridge MA. 1008 pages.
Gloire, puissance et splendeur, ou carnage, meurtre et ruine ? Quelles idées vous viennent en tête à l’évocation de l’Empire romain ? Est-ce l’image d’un aigle impérial doré, ou le marbre étincelant d’un arc de triomphe ? Ou peut-être l’empereur lui-même, Auguste ou Néron, coiffé d’une couronne de laurier et drapé de son vêtement impérial.
Les manuels d’histoire ont non seulement inspiré bon nombre de ces représentations mentales, mais ils nous ont aussi appris la majorité des connaissances que nous avons de l’une des plus importantes superpuissances de tous les temps : l’Empire romain, qui a vu le jour en 27 avant Jésus-Christ et qui, en l’an 285, était devenu trop vaste pour n’être gouverné qu’à partir de Rome, ce qui poussa l’empereur Dioclétien à le diviser en deux moitiés, l’une occidentale l’autre orientale. À l’Ouest, l’Empire disparut en 476, tandis qu’il perdura à l’Est sous la forme de l’Empire byzantin jusqu’en 1453. Les livres d’histoire soulignent aussi l’incroyable empreinte laissée par l’Empire romain sur la civilisation occidentale, notamment à travers le Saint Empire romain qui s’étala sur mille ans, de 800 à 1806.
Cependant, rares sont les textes à analyser comment l’héritage de l’Empire romain reste encore clairement reconnaissable aujourd’hui. Nous traitons ici trois ouvrages récents qui abordent ce sujet ; chacun d’eux présente des éléments qui s’écartent diversement des modèles historiques habituels, tout en reconsidérant l’impact de Rome et ses implications au XXIe siècle.
Les fondements d’un Empire
D’où viennent les empires et la notion d’empereur ? L’un des empires les plus anciens que l’on connaisse, celui de Chaldée (625‑539 av. J.‑C.), était aussi appelé Babylone, du nom de sa capitale ; son roi des rois était Nebucadnetsar (ou Nabuchodonosor), dont le règne est relaté dans le livre de Daniel. Il y eut ensuite l’Empire médo-perse (vers 558‑333 av. J.‑C.), qui tenait son nom du fait qu’il réunissait les Mèdes et les Perses. Il fut conquis par Alexandre le Grand entre 333 et 330 av. J.‑C., dessinant un troisième empire, celui de Macédoine (en Grèce). Pourtant, un quatrième, parti d’une seule ville, Rome, les éclipsa et les absorba tous.
Avant de devenir l’Empire romain, Rome était une république. Dans S.P.Q.R. (du latin Senatus Populusque Romanus, soit « le sénat et le peuple de Rome »), Mary Beard, professeure de lettres classiques à l’université anglaise de Cambridge, propose un récit révisionniste de Rome et de son formidable Empire. Son livre couvre en gros un millénaire, en partant de la création légendaire d’« un tout petit village très quelconque » par les jumeaux mythologiques Romulus et Remus au huitième siècle avant Jésus-Christ, jusqu’à l’octroi, par l’empereur Caracalla, de la citoyenneté romaine à tous les individus libres qui vivaient dans son immense empire au troisième siècle de notre ère.
Mary Beard s’attaque à la vision communément admise de la Rome antique en s’intéressant à l’opinion que les Romains avaient d’eux-mêmes ; elle montre ainsi comment la démocratie associée à la République, si farouchement gardée, céda la place à un régime impérial. Un facteur important a contribué à cette transition : l’ascension d’un chef militaire, héros capable de garantir une victoire sur le champ de bataille et une protection pour Rome. Le phénomène impose à l’auteure de revisiter les histoires de protagonistes célèbres tels que Jules César, Marc Antoine, Cléopâtre et Auguste, mais aussi de découvrir les approches généralement négligées de personnages moins importants : des Romains de rang inférieur dont nous n’avons probablement jamais entendu parler, dont des femmes, des esclaves et des affranchis, ainsi que les étrangers qui avaient été défaits par les héros conquérants de Rome.
« SPQR défie certains des mythes et semi-vérités à propos de Rome avec lesquels, moi comme beaucoup d’autres, nous avons grandi. »
Évidemment, les mythes qui entourent la fondation de Rome ne sont que cela, des mythes. Pourtant, comme Beard le note, dans la mesure où ils présentent une lecture a posteriori, « un microcosme, ou une version primitive imaginée de la cité ultérieure », ils restent informatifs. Par exemple, le mythe central des frères fondateurs de Rome ne se retrouve dans aucune cité grecque, du fait que Romulus envisageait d’accueillir à bras ouverts « tous les arrivants (étrangers, criminels, fugitifs) pour peupler sa nouvelle ville ». Cette capacité d’absorber des populations diverses allait caractériser l’évolution future de la cité. Beard fait également valoir que le mythe de Romulus et Remus, en lui-même, n’était pas uniquement l’histoire d’un meurtre, mais qu’il portait le « sombre message » que « le fratricide était inhérent au jeu politique romain. »
De même, les premiers temps de la Rome royale allaient finalement déterminer certaines facettes de l’Empire futur. Par exemple, on attribue à l’un des premiers souverains, Servius Tullius, la création du recensement, méthode de comptage et de classification de la population, qui intégra dans le système politique romain l’idée que le riche avait davantage le droit au pouvoir que le pauvre. Quant à Numa, il aurait formalisé l’organisation de la religion officielle romaine. Beard explique que l’un des ministères païens que Numa aurait fondé était le pontifex (bâtisseur de ponts) – en réalité un conseil sacerdotal. On en trouve l’écho actuellement dans le mot pontife. Il n’est pas très surprenant que l’Église catholique romaine ultérieure, sous la direction du pape Léon Ier (440‑461 av. J.‑C.), se soit concrètement structurée selon le schéma centralisé du gouvernement romain et ait donné au pape le titre sacerdotal de Pontifex Maximus. En un certain sens, c’est ainsi que le catholicisme romain s’est développé à l’extérieur de Rome grâce à une organisation et des antennes de gouvernance créées sur le modèle romain et toujours en vigueur aujourd’hui.
Des empereurs et des dieux
Adrian Goldsworthy, éminent historien de l’Antiquité, propose la même idée dans son ouvrage intitulé Augustus : First Emperor of Rome [Auguste, premier empereur de Rome]. Dans la lignée de Jules César qui, après son assassinat, sera divinisé (Divus Iulius), son fils adoptif, Auguste, allait porter le titre de Pontifex Maximus, une fonction « essentiellement politique » en tant que « prêtre le plus élevé et le plus prestigieux de Rome ». Goldsworthy atteste qu’à partir de la nomination d’Auguste, ce rôle sacerdotal « a toujours été assuré par un empereur, jusqu’à ce que Rome s’effondre et que le titre soit repris par le pape ». Ce point est donc essentiel si l’on veut saisir le lien entre le développement de l’Empire et le catholicisme romain. Les papes ont endossé un titre arraché aux empereurs de Rome, un titre associé à un pouvoir politique conçu à l’origine pour des prêtres païens.
La densité et l’ampleur du travail de Goldsworthy en tant qu’historien militaire donnent de la cohésion à sa biographie d’Auguste. Celle-ci retrace toute l’ascension de Caius (ou Gaius) Octavius, qui commença sa carrière en tant que « sénateur très secondaire » et finit premier empereur de Rome. Étant le petit-neveu et fils adoptif de Jules César (et étant devenu Caius Julius César), il fut conduit, après la mort de Jules en 44 av. J.-C., à rechercher tous les honneurs dont jouissait son père adoptif.
Goldsworthy s’attache tout particulièrement à clarifier les différents noms donnés à Auguste, accordant au fait que l’homme s’était autoproclamé César beaucoup plus d’importance que d’autres historiens. « Auguste n’a jamais voulu s’appeler Octave, et si nous lui donnons ce nom, au lieu de César, cela complique considérablement notre compréhension des événements qui se sont succédé pendant cette période. » Il fournit donc cette précision au début de son livre : « le dictateur sera toujours dénommé Jules César, et chaque fois que le texte indique César, il se réfère à Auguste. »
« Par convention moderne, on l’appelle Octave [...] en évitant complètement la dénomination “César” et, ce faisant, le risque de confusion avec Jules César. Bien qu’étant claire, cette option induit aussi fortement en erreur. »
En 43, le jeune César fut élu consul à seulement 19 ans. Son ascension se caractérisa néanmoins par un bain de sang. Les tensions entre Antoine, Lépide et lui s’apaisèrent temporairement avec la constitution d’un triumvirat à la tête de Rome. En janvier 42, Jules César était officiellement déifié, et un temple érigé en son honneur. Bien que le nouveau César n’ait pas immédiatement adopté la dénomination de « fils de dieu », l’implication logique était claire et, en quelques années, il devint l’un des hommes les plus puissants au monde.

L’Empire romain dan son territoire le plus vaste, vers 117 de notre ère
L’inévitable lutte de pouvoir qui naquit entre Antoine et César conduisit ce dernier à dépeindre son rival en envahisseur étranger ; après tout, Antoine ne s’était-il pas lié avec Cléopâtre d’Égypte ? En 31, la situation aboutit à la bataille d’Actium où César triompha. Il fut immédiatement « ajouté aux prières de tous les prêtres de Rome et des vierges vestales », coutume qui, d’après Goldsworthy, prouve « le besoin désespéré de paix et d’espoir que César devait satisfaire ».
En récompense de leur loyauté, les provinciaux étaient autorisés à prendre part au culte impérial, tandis que Nicée et Éphèse pouvaient élever des temples à Jules, empereur déifié, et à la déesse Roma. Ainsi, l’Empire et ses dirigeants étaient vénérés dans des contrées lointaines, mais pas sur le territoire italien. Alors que le jeune César commençait son septième consulat, il reçut une couronne de feuilles de chêne qui faisait de lui « le sauveur de tous les citoyens », et « les lauriers du vainqueur vinrent décorer le porche de sa maison à titre permanent ». De plus, « le consul président était dorénavant officiellement Imperator Caesar divi filius Augustus ». Le titre Auguste, écrit Goldsworthy, « s’accompagnait de lourdes connotations religieuses » compte tenu de son lien avec les augures, tandis que divi filius signifiait « le fils d’un dieu ». Il convient de noter avec Goldsworthy qu’il « reste plus de représentations d’Auguste que de tout autre homme ayant vécu pendant l’Antiquité ».
Quels qu’aient été ses titres soi-disant divins, « César Auguste Imperator a toujours été un chef de guerre dont la domination s’appuyait sur sa maîtrise d’une force militaire beaucoup plus importante que celle de tout autre dirigeant », explique Goldsworthy. Selon les critères modernes, il est resté un dictateur militaire ; en fait, un autre dictateur célèbre, Benito Mussolini, s’est auto-désigné Il Duce, voulant imiter délibérément le Dux Auguste.

L’Auguste de Prima Porta (vers 15 av. J.‑C.), sculpteur inconnu, Musée du Vatican. La statue de marbre fut découverte à l’extérieur de Rome dans une villa ayant appartenu à l’épouse de l’empereur, Livie. D’après le site en ligne du musée, le visage d’Auguste représenté à la manière d’Apollon cherchait à associer les caractéristiques de l’empereur à celles du puissant dieu.
Photographie de Till Niermann [GFDL, CC-BY-SA-3.0 ou CC BY-SA 2.5] via Wikimedia Commons
En août (du latin augustus, un mois à qui il avait donné son nom) de l’an 14 de notre ère, Auguste, « le père de son pays », mourut. Par la suite, le sénat déclara qu’il était non seulement le fils d’un dieu, mais un dieu lui-même.
On notera accessoirement que Jésus-Christ, appelé le Fils de Dieu et destiné selon la Bible à devenir « Roi des rois », est né pendant le règne d’Auguste, l’empereur à l’origine d’une lignée d’empereurs romains qui se voulaient rois des rois. Bon nombre de ces souverains humains allaient réclamer un statut divin et proposer le salut à leur peuple.
La forme sainte d’un Empire romain
Les germes que l’Empire romain avait plantés tout au long de son histoire n’ont pas disparu en 476, lors du saccage de Rome par ceux qu’on appelait les barbares. Le déclin de Rome avait déjà débuté avec la mort de l’empereur soi-disant chrétien Théodose le Grand en 395. Il fut le dernier à régner sur un Empire romain unifié avant l’effondrement de la partie occidentale.
Théodose avait instauré des pratiques religieuses qui allaient marquer les siècles à venir, notamment en introduisant l’expression chrétien catholique dans le christianisme romain. Ce complément du terme catholique, utilisé par Ignace au début du deuxième siècle pour décrire l’ensemble de la chrétienté, ajoutait une distinction importante : par édit impérial, un chrétien catholique signifiait désormais un croyant en la notion non biblique de la Trinité. Théodose jugeait hérétiques tous ceux qui n’étaient pas convaincus de la consubstantialité d’une « divinité trois-en-un » soufflant sur eux un châtiment divin.
Un siècle plus tard, tandis que l’Église et les restes de l’Empire se débattaient pour trouver un avenir viable, le pape Gélase Ier dépeignait les fonctions impériale et papale comme « deux épées » qui, ensemble, détenaient le pouvoir souverain sur le territoire. Dans le cadre de ce système, l’Europe passa de l’Empire romain au Saint Empire romain. Ce régime resta en place mille ans, « plus du double de la durée de la Rome impériale elle-même », note le professeur d’histoire d’Oxford Peter H. Wilson. La continuité et la légitimité du nouvel Empire étaient nées de l’idéal d’une civilisation chrétienne unifiée. Par conséquent, dans l’héritage de Théodose, l’aspect « saint » reposait sur la notion que l’Empire devait apporter la stabilité politique aux chrétiens catholiques face à tout ce que l’Église romaine jugeait hérétique.
Dans son ouvrage Heart of Europe [Cœur de l’Europe], Wilson retrace l’histoire du Saint Empire romain en Europe à partir de l’an 800, date du couronnement de Charlemagne, jusqu’à son terme en 1806.
« L’histoire impériale ne s’inscrit pas uniquement dans les différents historiques nationaux ; elle est au cœur de l’évolution de l’ensemble du continent. Pourtant, ce n’est pas ainsi que l’on présente habituellement l’histoire de l’Empire. »
Ce fut Charlemagne, le roi des Francs, qui créa un précédent en devenant l’empereur protecteur du pape et défenseur du christianisme romain. Il le prouva lorsqu’il se rendit à Rome pour la première fois à Pâque 774 et qu’il gravit à genoux les marches de la basilique Saint-Pierre en embrassant chaque degré avant sa rencontre avec le souverain pontife. Il veilla également à ce que la papauté reçoive les territoires que son père, Pépin, avait cédés à l’Église pour qu’elle crée un État pontifical. Ce fut donc vers les Francs et leur puissance naissante que le pape se tourna pour protéger Rome.
Lorsque le pape Léon III couronna Charlemagne empereur le jour de Noël 800, « il est très probable que Charlemagne ait été convaincu qu’il était fait empereur romain », précise Wilson, puisque « le trône byzantin était techniquement vacant [...]. Pour ses partisans, l’Empire [le Saint Empire romain] n’était pas une nouveauté de second ordre, mais une continuation directe de l’ancien Empire romain dont Léon « transférait » (transmettait) le titre de Byzance à Charlemagne et à ses successeurs. »
Wilson confirme que l’empire européen était « une création conjointe de Charlemagne et de Léon III » qu’il présente comme « l’un des occupants les plus retors » du trône pontifical, notamment à cause d’accusations de parjure et d’adultère. Mais au fil du temps, les empereurs se disputèrent la suprématie avec les papes. Les rôles de Pontifex Maximus et d’empereur, réunis autrefois sous la Rome antique, se retrouvèrent clairement prisonniers d’une lutte de pouvoir pendant la longue histoire d’un empire ainsi réinventé.
Au dixième siècle, le cœur du Saint Empire romain était le royaume germanique (qui donna naissance au Reich) dont le territoire finit par s’étendre de la mer du Nord et de la Baltique jusqu’à la Méditerranée et à l’Adriatique.
Wilson fait valoir que, même s’il avait perdu l’adaptabilité nécessaire aux changements politiques, économiques et sociaux, l’Empire était loin d’être un désastre jusqu’à la crise des guerres révolutionnaires françaises, lorsque Napoléon vainquit l’empereur François II à Austerlitz, précipitant la fin du Saint Empire romain. On ne peut s’empêcher de penser à d’autres entités telles que l’Empire britannique ou l’ancienne Union soviétique qui, elles aussi, se sont rapidement désagrégées ; cette approche jette également le doute sur l’aptitude des États-Unis à conserver sa domination mondiale actuelle.
Une quête perpétuelle d’unité européenne
Nous l’avons vu, l’influence de Rome a été longue et prégnante en Occident. L’argumentaire de Wilson est convaincant lorsqu’il montre que l’histoire impériale peut nous aider à comprendre les problèmes que l’Union européenne rencontre aujourd’hui. Il explique que « depuis l’élargissement de 2004 et la crise économique de 2008, les opinions sur l’UE se sont divisées encore plus nettement. Un camp défend une intégration plus poussée, y compris la création d’un Parlement européen, tandis que les nationalistes, comme ceux du UKIP (parti pour l’indépendance du Royaume-Uni), prétendent que « l’UE ne pourra jamais atteindre le degré de vitalité des États souverains ». Lorsque le Royaume-Uni a soumis les arguments des uns et des autres à un référendum national le 23 juin 2016, il est devenu le premier État membre à s’engager officiellement dans une sécession de l’Union.
« Il est loin d’être évident que la reconquête de la “souveraineté nationale” dans le périmètre préconisé par le UKIP et ses homologues des autres pays restaurerait la confiance des citoyens dans leur gouvernement national [...] déconnecté des besoins locaux et individuels. »
La situation est préoccupante pour l’Union dans son ensemble. L’élargissement, la libre circulation des personnes, ainsi que les niveaux disproportionnés de richesses et de possibilités d’enrichissement ont posé d’indéniables problèmes alors que les dirigeants s’efforcent de réussir la formule alchimique qui permettra l’adhésion des États membres entre eux. L’UE est en train de se battre pour galvaniser une égalité des forces à travers son territoire – et ce qu’on appelle le Brexit ne va guère aider dans ce sens.
Wilson assure que les comparaisons entre le Saint Empire romain et l’UE « peuvent se révéler instructives, pour ne pas dire flatteuses à l’égard soit de l’Union soit de l’Empire. Premièrement, [...] les systèmes politiques décentralisés n’ont pas forcément des intentions pacifiques ». L’Empire ne l’était certainement pas et, bien que l’UE n’ait pas (encore) de forces armées et reste globalement en paix, l’auteur rappelle que la France et le Royaume-Uni ont participé à des conflits sous le couvert de l’Union.
Deuxièmement, comme l’Empire, l’UE manque pour le moment d’une capitale et d’un « noyau politique clairement défini ». Tout au long de son histoire, l’Empire lui aussi resta abstrait, sans capitale établie et sans langue ni culture communes.
Troisièmement, selon Wilson, l’Union européenne « ressemble à l’Empire par l’absence d’un ensemble de citoyens homogène et organisé. Son rapport avec ses ressortissants est indirect puisqu’il passe par des échelons politiques autonomes, dont les États membres qui peuvent encore définir leurs propres critères de citoyenneté mais délivrent des passeports conférant des droits applicables dans toute l’Union. » Il observe que, jusqu’ici, le vieil Empire semble avoir mieux réussi à encourager un sentiment d’attachement entre ses citoyens.
Quatrièmement, tout comme dans l’Empire, la souveraineté au sein de l’UE reste fragmentée à ce stade. Jusqu’à maintenant au moins, comme pour l’Empire, « la mise en œuvre des politiques dépend de la coopération entre les membres ». De ce fait, l’Union reprend la formule impériale en obtenant des accords grâce à un système de pressions exercées par les homologues, système « souvent plus efficace et moins coûteux que la coercition ». Wilson explique que, comme l’UE, l’Empire « opérait en tolérant les différends et le mécontentement en tant que facteurs permanents de sa politique intérieure. Sans constituer un brouillon pour le projet européen actuel, l’Empire et son histoire suggèrent quelques idées pour mieux comprendre les problèmes d’aujourd’hui. »
Oublié, le passé !
Même si l’UE présente de nombreuses ressemblances avec l’Empire européen passé, le monde actuel manque des composantes qui permirent à l’ancien Empire d’accéder aux dimensions optimales de son intégration et de sa puissance : un chef considéré comme le sauveur du peuple, et un ordre pseudo-religieux ou religieux unique fondé sur un mythe qui s’impose à tous. Dans un climat économique mondial marqué par un désenchantement généralisé à l’égard de la politique, des hommes politiques et de la religion, il reste encore à établir le schéma commun qui pourrait s’imposer aux citoyens comme celui dont avait bénéficié l’ancien Empire romain. Indéniablement, la quête de richesse et de confort, le désir de sauvegarder les libertés de chacun, ainsi que la volonté de mettre un terme à tout conflit religieux, demeurent des pôles d’attraction convaincants, donc capables de rallier l’adhésion des masses à l’échelle planétaire.
Toutefois, quelle que soit la forme que de futurs empires pourraient prendre, la Bible nous présente clairement le modèle impérial défectueux qui s’est effondré au fil de l’Histoire en spécifiant qu’il ne peut tenir qu’un temps limité (Daniel 2 : 36‑45). Les entreprises humaines visant à bâtir une unité politique et religieuse n’ont pas apporté la paix mondiale. Lorsque Christ reviendra, il devra renverser les empires et puissances de ce monde pour établir le royaume éternel de Dieu sur terre (Apocalypse 14 : 8 ; 11 : 15). Ce royaume planétaire et son gouvernement ne ressembleront en rien à ce qui a précédé ; il ne connaîtra aucune forme de violence, de corruption ou de cupidité.
Par comparaison avec les autorités religieuses et séculières profondément imparfaites – et typiquement humaines – qui ont exercé leur pouvoir et leur domination sur les peuples et les empires terrestres, le prophète hébreu Ésaïe donne (en Ésaïe 9 : 5‑6) un aperçu de l’ampleur des divergences que présenteront le royaume de Dieu et son Roi : « Et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le zèle l’Éternel des armées. »
Pour nous, l’enseignement à tirer semble être que si Rome a, semble-t-il, défini la norme pour les empires et empereurs qui ont dominé le monde au cours des deux derniers millénaires – ce que nous montrent habilement les auteurs de ces trois ouvrages – elle ne peut pas servir de fondement au gouvernement qui régnera finalement sur terre. Et compte tenu du bilan de l’empire passé, on ne peut y voir qu’une bonne chose.