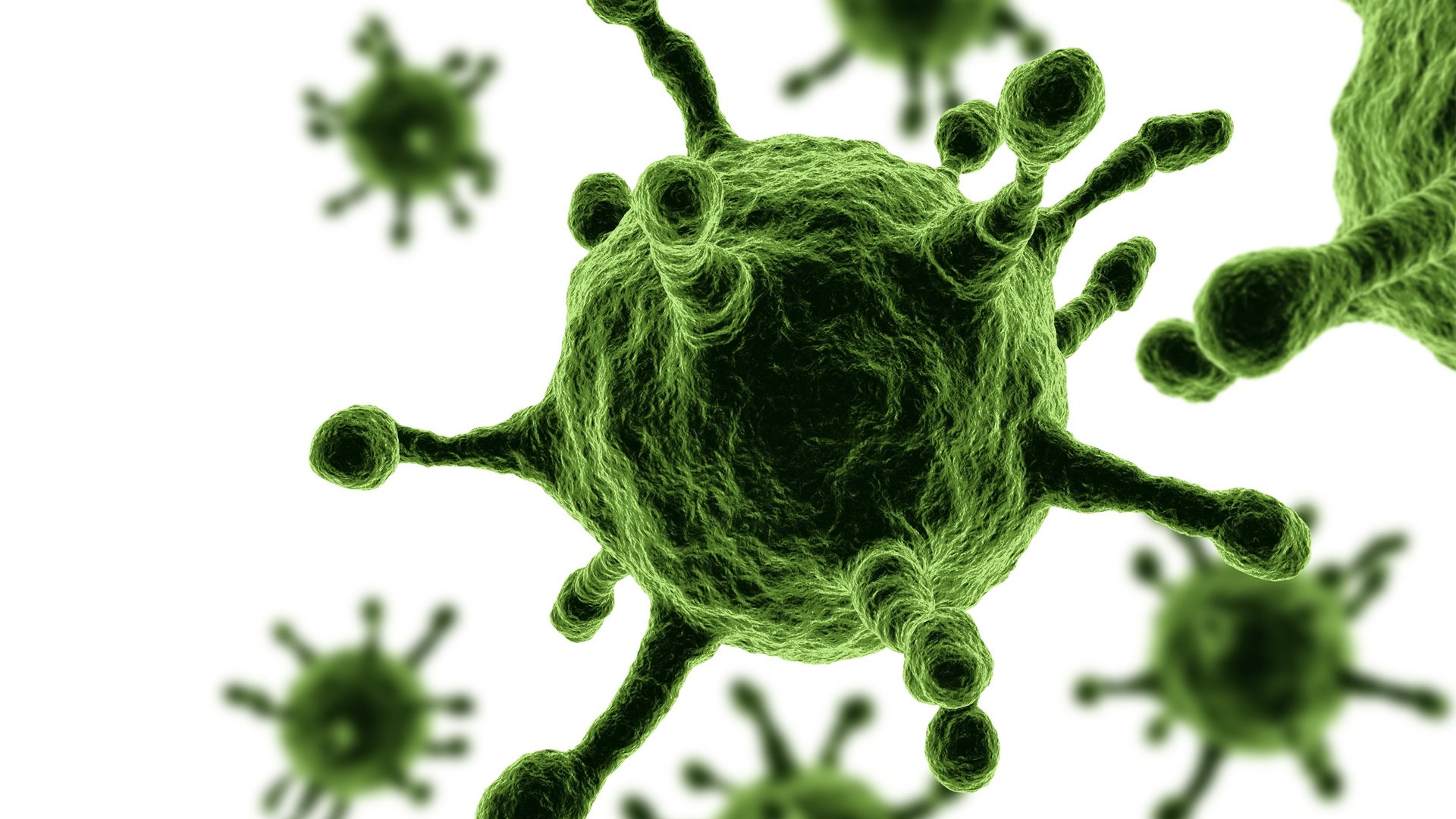Au-delà de la théorie des germes
Le dernier des quatre cavaliers de l’Apocalypse chevauche un cheval verdâtre qui symbolise les maladies et les épidémies, des situations que l’humanité connaît depuis des millénaires. À une époque, elles s’expliquaient en termes de punition divine mais, de nos jours, il nous est difficile d’échapper à notre responsabilité.
Quand le capitaine Cook débarqua aux îles Hawaï à la fin des années 1770, les habitants virent en lui Lono qui, dans leurs traditions, était le dieu de la paix et des bienfaits agricoles. Les autochtones l’accueillirent avec des présents, viandes et fruits tropicaux divers. En échange, Cook et son équipage offrirent aux Hawaïens des miroirs et des tissus. Ils ont aussi ouvert la porte à la syphilis, la blennorragie, la tuberculose et la grippe.
Pour la population locale qui n’avait pas d’immunité innée contre ces nouveaux germes, ce contact s’est révélé apocalyptique. Les épidémies qui suivirent les visites de Cook et d’autres ramenèrent la population indigène de plus d’un million à moins de 90.000 habitants vers les années 1850.
Une mort mystérieuse
Il est certain que les maladies infectieuses sont restées un grand mystère pendant très longtemps. Même si les Écritures hébraïques donnaient déjà des instructions relatives à la quarantaine et aux mesures sanitaires, ce n’est qu’assez récemment que des techniques d’hygiène de base ont été scientifiquement identifiées et encouragées. Par exemple, ce fut à la fin des années 1800 que la première consigne générale que nous entendons dans notre vie (« Lave-toi les mains ! ») démontra sa cohérence scientifique.
« Entre sa naissance et sa mort, l’homme est exposé à l’activité de nombreux microbes. »
Avant que Joseph Lister, Louis Pasteur et Robert Koch ne développent la théorie des germes infectieux (ou théorie microbienne), on croyait que la plupart des maladies étaient spontanées. Se laver les mains et nettoyer surfaces ou instruments chirurgicaux semblait alors superflu. La propagation des maladies était chose courante ; d’une certaine façon elle était inévitable. Quand tout le monde mourait dans un hôpital, on choisissait de démolir le bâtiment et de le reconstruire une fois que les miasmes et les émanations dangereuses s’étaient dissipés. À partir de cette époque, le chemin fut long et semé d’embûches jusqu’aux antiseptiques Listerine, à la pasteurisation et à l’identification par Koch des germes de maladies spécifiques. Avant, tout était mystère.
Il est facile, alors, de comprendre que la nature sporadique des maladies et épidémies constituait un problème déroutant pour les individus et les populations. Pourquoi certains tombent-ils malades, et d’autres pas ? D’où vient la contagion ? Qu’avons-nous fait pour mériter cela ? Raison, religion et imagination ont été mises en demeure de trouver des réponses. Bon nombre ont même demandé s’il existait quelque chose « dans les étoiles » qui commandait ces fléaux ?
Les fléaux de Dieu
Comme l’imagerie, de la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, présente souvent les corps célestes comme des repères ou des signes, certains pourraient être tentés d’y voir par erreur les messagers de désordres sur terre. Les astrologues recherchaient des motifs répétitifs et les associaient à des évènements particuliers, comme les éclipses ou les comètes, pour composer la prédiction d’un avenir fragile. Mais la plupart, s’accordant finalement pour dire que Dieu était la Cause première, concluaient que tout ce qui arrivait relevait du jugement divin.
La Bible elle-même semblait confirmer cette idée. À sa lecture, il paraissait juste d’attribuer, par exemple, une origine divine à l’Exode et aux fléaux lancés contre les Égyptiens (Exode 7‑11). Plus tard, Jérémie avertit Israël du courroux du Seigneur exprimé par « l’épée, la famine et la peste » (Jérémie 14). Il n’est donc pas étonnant que la peste noire ou peste bubonique des années 1300 ait aussi été attribuée à Dieu, la propagation puis le recul de toutes les épidémies étant interprétés comme les termes de sa vengeance à l’égard de l’humanité pécheresse.
Mais le cheval verdâtre d’Apocalypse 6 : 8, souvent associé à l’imminence grandissante de la fin des temps, a régulièrement tracé son sillon durant plusieurs centaines d’années. Entre 1348 et 1665, des épidémies ont éclaté à travers l’Europe plus de quarante fois. Aujourd’hui, ceux d’entre nous qui descendent des survivants portent en eux des séquences génétiques qui semblent transmettre une résistance aux bactéries. En conséquence, parallèlement à l’inscription des maladies dans notre culture, nous pouvons, grâce au génome des vivants et des morts, retracer les voyages en tous sens des bactéries à travers l’Europe et l’Asie. Comme le notent les historiens Andrew Cunningham et Ole Peter Grell, « dans un monde où l’espérance de vie était d’environ 35 ans, la plupart des gens connaissaient une épidémie à l’échelle européenne ».
Lors de l’un de ses épisodes, en 1563, l’archevêque de York et de Canterbury, Edmund Grindal, écrivait : « Alors rappelons-nous que nous avons poussé Dieu à venir parmi nous en cette époque, avec la peste et d’autres maladies graves, [...] et prions Dieu avec ferveur et sincérité pour qu’il détourne de nous son courroux mérité et qu’il nous rende la santé des corps par la salubrité de l’air, mais aussi une paix et une tranquillité pieuses et bénéfiques ». Pour Grindal, la maladie était le moyen que Dieu utilisait pour nous remettre « en mémoire [sa] justice et [son] jugement, ainsi que notre misérable fragilité et notre mortalité ».
Bien que nous ayons maintenant une compréhension précise des causes biologiques des maladies infectieuses, nombreux sont ceux qui, même aujourd’hui, voient dans la puissance pandémique des microbes le courroux latent de Dieu, prompt à châtier le pécheur.
Mais que nous dit le cycle permanent des maladies à propos de la condition humaine ?
De la théologie à l’écologie
Comme à la grande époque de ce genre de ferveur, il est facile de se laisser aller à penser que les fléaux modernes sont un signe de la fin, une sorte de canari dans la mine de charbon de la moralité humaine. Après tout, il n’y a pas si longtemps que le VIH ou le SIDA était la marque du péché, de la déchéance morale.
Pourtant, une infection n’est pas un esprit, pas plus qu’une vapeur, un miasme ou une force mystérieuse. C’est une entité biologique : une bactérie, une spore, un virus. Et comme tout ce qui est biologique, elle a une raison d’être et des stratégies précises grâce auxquelles elle interagit avec les autres formes de vie, comme lorsqu’elle infecte un être humain. Ainsi que l’explique Jared Diamond dans son livre intitulé en français De l’inégalité parmi les sociétés, une maladie a besoin de nouveaux corps à infecter. Mais une fois la stratégie découverte, qui est responsable de la propagation de la maladie : le microbe ou l’homme ?
Dans cette lutte entre microbe et hôte humain, les pertes ont été nombreuses et tragiques, c’est certain. Martin J. Blaser, qui dirige un programme de la New York University consacré au microbiome humain, explique ceci : « La peste noire s’est ainsi déclarée en Europe en 1347 et, en une décennie, elle a tué entre un quart et un tiers de la population. Une fois introduite, elle se propageait même sans les rats, les puces infectées sautant d’une personne à l’autre, et les individus atteints de la peste pulmonaire la transmettant par la toux » [La Santé par les microbes, trad. fr. Flammarion, 2014].
Cependant, le véritable coupable n’était pas la bactérie, mais l’ampleur, la misère et la densité de la population humaine qui, ensemble, furent les déclencheurs de la pandémie. Une maladie infectieuse n’est pas un signe du courroux divin ; le SIDA, par exemple, est une conséquence biologique normale d’un contact avec des primates ou de la consommation de ces animaux par l’homme (viande de brousse), d’une mutation virale et de l’entêtement à poursuivre des pratiques dangereuses. Le comportement humain est le coupable, la véritable cause première de ce fléau moderne. On peut en dire autant de la plupart des maladies infectieuses potentielles que nous craignons.
Martin Blaser ajoute que la complicité des hommes a attisé une épidémie plus contemporaine : « En 1993, la peste a éclaté à Kinshasa, au Zaïre. Les années de guerre et la corruption ont poussé le gouvernement à battre monnaie. Il en a résulté une inflation galopante ; on achetait ce qu’on pouvait, sachant que le lendemain les prix monteraient. Les réserves de céréales s’accumulèrent, ce qui attira dans les foyers les rats, et la peste dont ils étaient porteurs. »
Le choléra est une autre maladie fréquemment étudiée. Causée par une bactérie, cette infection se traduit par des vomissements et des diarrhées qui entraînent la mort par déshydratation. Tout le monde savait que ce fléau était lié à la contamination de l’eau quand la Manhattan Company a fourni la ville de New York en s’approvisionnant sur un site de rejet des eaux de ruissellement situé dans le tristement célèbre quartier déshérité de Five Points. L’épidémie qui s’en est suivie à partir de 1832 était totalement prévisible, la vraie cause étant économique : il était plus rentable de tirer de l’eau d’un bassin de dégorgement que de l’acheminer depuis la rivière par des canalisations.
Comme le remarque l’auteure scientifique et journaliste d’investigation Sonia Shah, « même la virulence d’un pathogène à l’origine de pandémies comme Vibrio cholerae dépend entièrement de son contexte. Dans l’organisme, c’est un pathogène ; dans les eaux chaudes d’un estuaire, c’est un élément productif d’un écosystème harmonieux. Et une grande part de sa transformation, de microbe inoffensif en pathogène virulent, tient à nos propres activités. Nous en avons nous-mêmes fait un ennemi. »
« Bouleversements, migrations, manques cruels d’installations sanitaires : tous ces facteurs naissent des politiques, et tous redonnent aux maladies infectieuses la possibilité de se répandre et d’ajouter leur part de dévastation. »
Tel un cheval de course, le cheval pâle de l’Apocalypse est aiguillonné par nos propres actes. On ne reproche pas à un bébé de pleurer ; on cherche la cause du problème. Nous découvrons ici que c’est le facteur humain qui favorise la maladie infectieuse ou qui la broie ; il s’agit d’un dysfonctionnement écologique ou relationnel, pas d’un simple défi médical. Puisque c’est l’homme qui mène la charge des quatre cavaliers, le problème des épidémies n’est pas impossible à résoudre.
Un équilibre à trouver
Le quatrième cavalier est le dernier des vecteurs de souffrances et de douleurs des hommes : de faux messies qui brandissent l’épée de la guerre en se massacrant stupidement les uns les autres pour des acquisitions temporelles ; une épidémie, contagion invisible qui s’infiltre pour nous frapper apparemment au coup par coup ; les aléas dus aux « bêtes sauvages », déséquilibres naturels qui nous immobilisent ; et, enfin, la crainte persistante de l’humanité, la mort elle-même (Apocalypse 6 : 8b).
Notre Créateur nous assure que dans un temps à venir, tout sera rétabli. La mort disparaîtra enfin : « J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse 21 : 3‑4).
Les choses que nous craignons aujourd’hui – guerres, famines et pandémies qui jalonnent l’histoire des hommes – seront écartées un jour, mais pas à la suite d’une intervention magique ou d’un changement de la nature de Dieu, comme si Dieu avait provoqué ces évènements. Puisque ceux-ci découlent de notre nature (notre gestion, bonne ou mauvaise, du monde et de nos relations), le point de transformation doit être en nous-mêmes. Ce qui importe, ce n’est pas de se laver les mains, mais de se laver le cœur (Matthieu 15).
Il est indubitable que les microbes ont affecté l’histoire des hommes et qu’ils continueront de le faire. Ils sont une force avec laquelle il faut compter sur de nombreux plans. Dans certains cas, il vaut mieux éliminer ces organismes (dans les réseaux d’eau potable ou lors des opérations chirurgicales, par exemple). Mais dans d’autres situations, comme à l’intérieur de notre système digestif, un mutualisme se produit entre notre microbiome intérieur et notre santé extérieure, sujet sur lequel nous devons en apprendre davantage. Et à mesure que notre savoir se développe, notre responsabilité s’accroît.
Le facteur le plus important, alors, n’est pas la science mais la conscience. « Le dévouement des épidémiologistes, des chercheurs scientifiques et des professionnels de santé ne suffira jamais contre les forces supérieures, et sans cesse rééquilibrées, qui continuent de confiner une telle proportion de l’humanité dans une totale privation », écrit Jim Whitman, directeur de l’ouvrage intitulé The Politics of Emerging and Resurgent Infectious Diseases [Politiques liées aux maladies émergentes et renaissantes]. « Les maladies infectieuses sont autant des phénomènes sociaux que microbiens, et trouver des parades à leurs attaques tout en améliorant le sort des millions d’individus actuellement affectés est autant une tâche politique que médicale et scientifique. »
Il existe un équilibre entre germes et homme ; toutes les formes de vie sur terre sont intégrées les unes avec les autres. Épidémies, maladies et morts sont le résultat de déséquilibres que, dans de nombreux cas, nous avons créés, et dont nous subissons les conséquences. Les pestes ne sont pas de simples accidents de la nature ; elles sont la conséquence d’actes humains, même si ces derniers ont été commis par méconnaissance.
James Cook ne pouvait pas prévoir la catastrophe que sa mission provoquerait. En revanche, il est difficile aujourd’hui de demeurer dans l’ignorance.