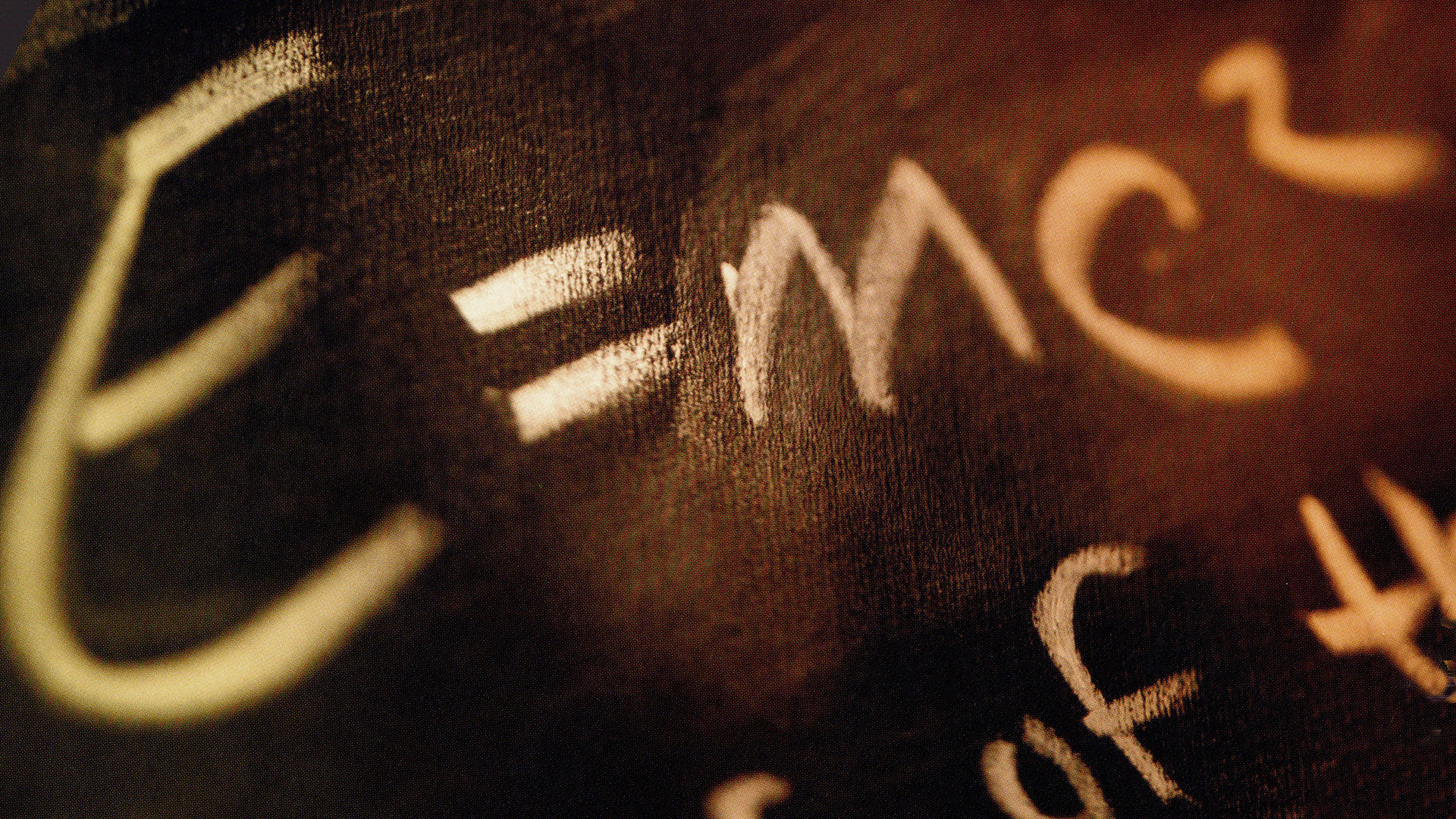Positivement aucun absolu ?
On admet communément que les progrès scientifiques ont eu un énorme impact sur la technologie. Or, on a rarement observé l’influence de la science et de la méthode scientifique sur la philosophie du vingtième siècle.
Les épisodes précédents de notre étude sur quelques idées dominantes fondatrices de notre monde moderne ont démontré qu’une simple conjecture déguisée en vérité scientifique peut, dans bien des cas, avoir de graves conséquences si elle est appliquée à la sphère sociale de l’humanité.
Pour la plupart des gens, l’acceptation générale des thèses non démontrées de Charles Darwin sur l’origine des espèces – thèses qui désavouent l’éducation religieuse de leur concepteur – a repoussé Dieu auteur de la Création dans de lointaines ténèbres. En conséquence, non seulement la théorie de l’évolution en a privé plus d’un de toute possibilité de foi dans le Créateur biblique, mais elle a érigé la concurrence sans merci et la survie sanguinaire des plus aptes en mode de fonctionnement caractéristique de la société humaine.
Ce que Darwin a essayé en biologie, Karl Marx l’a tenté sur le terrain économique. Son fantasme politique du prolétariat a saccagé des millions de vies, le marxisme-léninisme ayant conquis une bonne partie du monde au vingtième siècle. De plus, Marx avait promis l’affranchissement de l’addiction toxicomaniaque pour la religion occidentale et pour son Dieu. Malheureusement, ce régime athéistique générateur de violence n’a connu une faillite totale qu’après une centaine d’années de cruelles expériences.
À l’instar de Darwin et de Marx qui aspiraient au titre de héros scientifique, Sigmund Freud se voyait pionnier dans la prospection de l’intimité humaine. Par malheur, il a laissé son penchant personnel pour les acclamations de la foule éclipser toute auto-évaluation critique de sa prétendue science du cerveau. Bien que reposant sur de maigres fondements, ses idées sont pourtant devenues la panacée universelle dès qu’il s’agit de comprendre enfance, influence parentale et sentiments ou émotions les plus profondes. Brandissant la conviction que la sexualité primaire était la source de tout comportement humain, Freud n’avait aucun besoin des règles morales prônées par un Être divin. Malgré son héritage juif et quelques influences chrétiennes dans son jeune âge, il a fini par considérer Dieu comme le fantasme d’une image paternelle, sans plus.
Darwin, Marx et Freud ont tous trois été des praticiens de la méthode scientifique. Ils ont prétendu procurer un nouveau savoir d’une manière objective et fiable. Pourtant, l’impact de leurs idées a été extrêmement néfaste quant à la compréhension humaine des domaines subjectifs et spirituels. La science, dans son exigence de phénomènes physiques, a rapidement banni toute expérience individuelle psychique ou métaphysique. En effet, ce genre d’expérience ne s’appuie, selon elle, sur aucune réalité. Ce qui est curieux dans la recherche scientifique, c’est qu’elle émane de méditations personnelles : Darwin, Marx et Freud ont commencé par réfléchir à certains aspects du monde qui les entourait, et leurs réflexions appartenaient au domaine du subjectif et du métaphysique.
Malgré l’origine trouble des « spéculations faites vérités » scientifiques, il n’est pas surprenant que bon nombre de ceux qui revendiquent la qualité de « scientifique » restreignent le champ de la métaphysique dans la vie. C’est ainsi que, pour beaucoup, science et religion ont abouti à une impasse, au mieux à une trêve inconfortable, au pire à un échange d’insultes malsain. Citons Richard Dawkins, fervent évolutionniste, professeur à Oxford : « On peut assurément affirmer que si on rencontre quelqu'un qui déclare ne pas croire en l'évolution, cette personne est ignorante, stupide ou folle (ou bien mal intentionnée, mais je préfère ne pas l'envisager). »
Albert Einstein commentait déjà cette triste situation en 1917. Préoccupé par l’effondrement des relations entre les sphères religieuses et culturelles, il écrivait : « L’union essentielle des institutions culturelles ecclésiastiques et séculières s’est perdue au cours du dix-neuvième siècle, jusqu’à atteindre un stade d’hostilité insensée. » Arrogance et intolérance n’ont fait qu’entraîner la discussion dans un embarrassant cul-de-sac ; si l’on en croit cette approche, l’existence humaine n’est qu’une expérience stérile où tout n’est que savoir-faire et où rien ne peut être dit sur la signification et le dessein de la vie.
COMMENT DEVENIR POSITIVISTE
Dans cette série sur les idées dominantes qui ont bouleversé les modes de réflexion modernes, les deux dernières perspectives sont liées plus ou moins étroitement à l’entreprise scientifique. Ces deux doctrines connexes, le positivisme et le relativisme, ont non seulement empêché une majorité de gens de croire en quoi que ce soit hormis ce qui pouvait être perçu par les cinq sens, mais elles les ont aussi détournés de l’idée qu’il existait des absolus.
Le positivisme constitue l’ossature philosophique de la méthode scientifique. Se fondant sur l’empirisme, il a défini la vision du monde scientifique la plus répandue. Il voulait se dissocier totalement du métaphysique, du subjectif, de l’immatériel. Seul ce qui peut être constaté par nos sens est réel : toute autre chose n’existe que dans le domaine de l’imagination et ne peut être un savoir. Le positivisme a connu son heure de gloire avant d’être remplacé en grande partie par le post-positivisme vers le milieu du vingtième siècle ; néanmoins, la priorité qu’il confère à l’observation matérielle demeure une conviction très courante.
Trois courants de pensée positiviste se sont développés au fil du temps. Le premier est associé au philosophe Auguste Comte (1798-1857), père du positivisme et fondateur de la sociologie en tant que discipline scientifique. Comte intégra de manière cohérente les approches théoriques antérieures de Francis Bacon, George Berkeley et David Hume. Au Royaume-Uni, ses contemporains étaient John Stuart Mill et Herbert Spencer lesquels, en plus de concevoir une philosophie de l’acquisition du savoir et de la logique, travaillaient sur l’application du positivisme dans la création d’un ordre social équitable.
Les recherches de Comte sur le positivisme le guidèrent sur une voie plutôt curieuse, puisqu’il était convaincu que les modes de pensée métaphysiques étaient alors dépassés. Plus tard, il s’impliquera dans le mysticisme et cherchera à remplacer la religion chrétienne traditionnelle par la religion de l’Humanité dont il définit lui-même les rites.
La deuxième phase du positivisme correspond à l’étude empiriocritique du physicien autrichien Ernst Mach (1838-1916) pour qui toute connaissance était issue d’une sensation ou d’une expérience sensorielle. En science, toute assertion devait être vérifiable empiriquement, et toute notion métaphysique, telle que la nature absolue de l’espace ou du temps, était inacceptable. Ce furent les idées révolutionnaires de Mach sur le temps et l’espace qui inspirèrent la réflexion d’Einstein sur la théorie générale de la relativité.
Le positivisme a été prépondérant au dix-neuvième siècle, comme le rapporte la Catholic Encyclopedia : les principes et l’esprit du positivisme ont envahi la pensée scientifique et philosophique du dix-neuvième siècle et exercé une influence pernicieuse dans toutes les sphères ; en pratique, leurs conséquences ont affecté, d’une part, les préceptes de la moralité positive (dite scientifique) et de l’utilitarisme au plan éthique et, d’autre part, les doctrines de la neutralité et du naturalisme au plan religieux.
Le troisième courant de l’évolution positiviste, le néopositivisme ou positivisme logique, est associé à l’École de Vienne et, notamment, à Rudolf Carnap (1891-1970). Ce groupe de philosophes et scientifiques tentèrent de combiner des travaux philosophiques traitant du langage et de la logique symbolique et mathématique pour expliciter la nature de la recherche scientifique. Le philosophe néo-positiviste anglais Bertrand Russell (1872-1970) synthétisa parfaitement le scepticisme de cette perspective en déclarant que même en mathématique, nous ne savons jamais de quoi nous parlons ni si ce que nous disons est vrai. Malheureusement, l’idée que nous ne pouvons pas savoir avec certitude de quoi nous parlons dans bien des domaines de la vie, en particulier dans ceux de la morale et de l’éthique, est devenue terriblement handicapante pour la société.
« La science peut nous aider à surmonter cette lâche crainte au sein de laquelle l’humanité a vécu pendant tant de générations. »
Russell était connu pour son opposition à la foi religieuse. Dans l’un de ses célèbres textes, il expliqua pourquoi il n’était pas chrétien. Il déclara notamment : « En ce monde, nous commençons à comprendre les choses, à les maîtriser un peu à l’aide de la science – qui s’est frayée peu à peu un chemin malgré l’opposition de la religion chrétienne, des Églises en général et de toutes les superstitions. La science peut nous aider à surmonter cette lâche crainte au sein de laquelle l’humanité a vécu pendant tant de générations. La science peut nous enseigner, et je pense que notre propre cœur peut nous enseigner aussi à ne plus rechercher autour de nous des appuis imaginaires, à ne plus nous forger des alliés dans le ciel, mais plutôt à concentrer nos efforts ici-bas afin de faire de ce monde un lieu où l’on puisse vivre convenablement, contrairement à ce qu’ont fait les Églises au cours de siècles. […] Toute la conception de Dieu est une conception tirée du vieux despotisme oriental. C’est une conception absolument indigne d’hommes libres. Quand je vois des gens qui se courbent à l’église en confessant qu’ils sont de misérables pécheurs, et tout ce qui s’ensuit, je juge cela méprisable, indigne du respect qu’on se doit à soi-même. » [Trad. G. Le Clech, J.J. Pauvert Éd., 1972].
Pourtant, comme nous le verrons, tous les brillants cerveaux scientifiques n’ont pas adopté cette noire vision d’un « allié dans le ciel ».
TOUT EST RELATIF : VRAI OU FAUX ?
L’autre doctrine qui a considérablement influencé la pensée et le style de vie d’un grand nombre de personnes au cours des quelque cent dernières années est le relativisme, notion selon laquelle il n’existe aucun absolu moral. Ses liens avec la science ne sont que marginaux. Par une curieuse perversion des conclusions révolutionnaires d’Einstein sur le temps, la distance et le mouvement, les résultats empiriques du scientifique sur la relativité de ces concepts se sont confondus, dans l’esprit de la population, avec le relativisme moral. En revanche, le génie suisse croyait fermement en des normes absolues du vrai et du faux. Aucune tergiversation n’était possible selon lui : « La relativité s’applique à la physique, non à l’éthique ». En fait, il disait que ses théories n’étaient porteuses d’aucune implication philosophique : « Le sens de la relativité a été bien souvent incompris. Les philosophes jouent avec le mot, comme une enfant avec une poupée. [...] Cela ne signifie pas que, dans la vie, tout est relatif. »
Einstein disait que ses théories n’étaient porteuses d’aucune implication philosophique.
Effectivement, Einstein avait montré que, dans le monde objectif de la science, des concepts très courants n’étaient pas absolus. Cependant, il n’a jamais laissé la relativité, encore moins le relativisme, accéder à l’univers intérieur subjectif des êtres humains. Apparemment, il s’est contenté d’entretenir la distinction entre le subjectif et l’objectif. Son intérêt pour la relativité plaçait son idéologie sur le terrain de l’objectivité. Personnellement, il était convaincu que le relativisme moral était un mal, sans aucun lien avec l’œuvre de sa vie concernant la relativité. Il fut très chagriné que ses découvertes génèrent des implications morales inattendues et précisa que la teneur d’une théorie scientifique ne procurait intrinsèquement aucun fondement moral pour la conduite d’une vie individuelle.
La frénésie que suscitèrent ses idées lui faisait parfois souhaiter n’avoir été qu’un simple horloger. Selon Paul Johnson, ce ne furent pas les découvertes d’Einstein sur la nature de l’univers qui contribuèrent à laisser la société dériver loin de ses ancrages traditionnels dans la foi et les morales de la culture judéo-chrétienne. Ce fut l’acceptation générale et sans contestation de l’idée – toute différente – qu’aucun absolu n’appartenait à la sphère morale. Bien des personnes entendirent ce qu’elles voulaient entendre et s’autorisèrent à créer une nouvelle moralité à leur propre image.
L’auteur et intellectuel britannique Aldous Huxley (1894-1963) est une illustration à cet égard. Il fit un aveu évocateur sur ce genre de moralité individuelle dans son essai autobiographique intitulé La Fin et les Moyens. Décrivant l’affranchissement que lui-même et ses jeunes collègues recherchaient par rapport aux idées chrétiennes, il écrivait : « Pour mon compte, comme, sans doute, pour la plupart de mes contemporains, la philosophie de l’absence de signification fut essentiellement un instrument de libération. La libération que nous désirions était simultanément la délivrance à l’égard d’un certain système politique et économique, et la délivrance d’un certain système de morale. Nous étions opposés à la morale parce qu’elle gênait notre liberté sexuelle [...] » [Trad. J. Castier, Plon, 1939].
Afin de légitimer leur comportement personnel, Huxley et ses homologues ont choisi d’affirmer que la vie n’avait aucun sens.
Afin de légitimer leur comportement personnel, Huxley et ses homologues ont choisi d’affirmer que la vie n’avait aucun sens. D’après Huxley, ni Darwin ni les positivistes n’étaient en mesure d’apporter une justification quelconque, même si leurs héros (les penseurs des Lumières) leur en avaient fourni les bases. Le fait est que la respectabilité victorienne avait étouffé les implications d’une existence dépourvue de signification. En conséquence, ce ne sera pas avant la fin de la Première Guerre mondiale que Huxley pourra s’expliquer en arguant de ce qu’il appelle sa « révolte politique et érotique ». Cette approche s’est ensuite nourrie du positivisme, lequel invitait à conclure que, puisque l’observable équivaut à tout ce qui est valide, le métaphysique ou l’immatériel, tels les principes religieux, n’a pas de signification.
S’agissant du gouffre creusé entre la science et la religion, là encore Einstein proposa une sage réflexion. Tentant d’expliciter comment les acteurs scientifiques étaient obligés de procéder, il écrivait : « Pour le scientifique, il n’existe qu’un seul "être", pas de souhait, pas de valorisation, pas de bien, pas de mal ; pas de finalité ». Ainsi, si l’on en croit l’un des plus grands génies de la science, la nature même de la recherche couramment pratiquée la soustrait de l’univers du bien et du mal. Lorsque l’on cherche une vérité scientifique, on opère en terrain neutre aux plans éthique et moral.
En conséquence, Einstein poursuivait : « Tant que l’on reste dans le domaine de la science proprement dite, on ne peut en aucun cas rencontrer une phrase du genre : "Tu ne mentiras point" ». Malheureusement, c’est ainsi que naissent la plupart des erreurs lorsque la moralité d’une approche scientifique est mise en question. Les interrogations de ce type sont reléguées hors du champ de recherche d’une vérité scientifique.
Toutefois, Einstein ne craignait pas de déclarer que des principes qui, à l’instar des commandements bibliques, interdisaient de proférer des mensonges étaient importants et justifiables : « Nous n’avons pas du tout le sentiment qu’il soit insensé de s’interroger sur les raisons pour lesquelles nous devrions mentir. Nous estimons qu’un tel questionnement est porteur de sens puisque, dans toute discussion de ce genre, certaines prémices éthiques sont implicitement considérées comme allant de soi. »
Il savait que, si le mensonge n’était pas interdit, personne ne pourrait faire confiance à autrui. Cela marquerait la rupture de la communication et de la coopération humaines. À son avis, la règle « tu ne mentiras point » s’appuyait sur le désir naturel des hommes de préserver la vie et de minimiser douleur et souffrances. En reliant l’étude scientifique à la recherche d’une vérité éthique, il disait que « les axiomes éthiques sont découverts et essayés d’une manière guère différente des axiomes scientifiques. La vérité est ce qui passe le test de l’expérience. »
EXPÉRIMENTER DES ABSOLUS
D’un point de vue biblique, neuf autres absolus accompagnent celui qu’Einstein a choisi pour illustrer sa réflexion sur la similitude entre recherches scientifique et éthique. Une fois réunis, nous les connaissons sous le titre des Dix Commandements.
Que nous apprennent ces principes censés émaner de l’Être suprême ? Les quatre premiers se rapportent à la relation qui unit les hommes et leur Créateur. Ils fixent la règle sur la manière dont le créé doit répondre au créateur.
Paul, l’un des auteurs du Nouveau Testament, étudie les implications sur la pensée philosophique de son époque à l’égard du monde créé. Selon lui, en ignorant délibérément les signes du Créateur dans le monde naturel, les gens « retiennent injustement la vérité captive ».
Il explique que la preuve de l’existence de Dieu était accessible à l’intellect des hommes : « ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Romains 1 : 18-20).
Paradoxalement, c’est en observant la nature que Paul affirme que nous pouvons parvenir à la connaissance du Créateur.
Paradoxalement, c’est en observant la nature que Paul affirme que nous pouvons parvenir à la connaissance du Créateur. Il était convaincu que ceux qui reniaient la manifestation d’une création autour d’eux étaient au comble de l’absurde. En cherchant à être savants, ils avaient troqué la magnificence et la vérité du Dieu créateur contre des images reproduites d’après l’univers naturel. Finalement, ils avaient vénéré la création au lieu du Créateur. En conséquence, les quatre premiers commandements définissent notre relation vis-à-vis du Créateur, respect à son égard et absence d’idolâtrie, autrement dit de substitution de quoi que ce soit à la primauté de Dieu, Créateur de l’humanité.
Les six derniers commandements définissent les rapports entre les hommes. Comme l’observait Einstein, interdire le mensonge est une bonne mesure, favorable à la cohésion sociale. Ce principe éthique a, sur la vie humaine, un effet positif manifeste. De même, on peut facilement montrer que le respect à l’égard des parents et les interdictions de meurtre, d’adultère, de vol et de convoitise contribuent à la préservation et à la protection d’une société dans laquelle il fait bon vivre.
Nous avons commencé cette série en reconnaissant que certains penseurs avaient admis le pouvoir destructeur de ces six idées dominantes au sein de la civilisation occidentale moderne. L’un d’eux, E.F. Schumacher, a également affirmé que la personne réellement instruite n’est pas celle qui sait tout sur tout (si cela se révélait possible) ni même un peu de tout, mais plutôt celle qui est en prise avec le noyau central. Le noyau, c’est le cœur métaphysique et éthique de la vie, les concepts qui constituent nos convictions, qui n’appartiennent ni à l’univers des faits ou de la science, ni à l’observable, tout en étant conformes à la réalité.
Ce que je suggère ici, c’est que les Dix Commandements constituent simplement un cœur d’absolus, inspiré et offert à l’humanité par un Dieu créateur tout en sagesse qui sait exactement ce dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec lui et nos semblables.